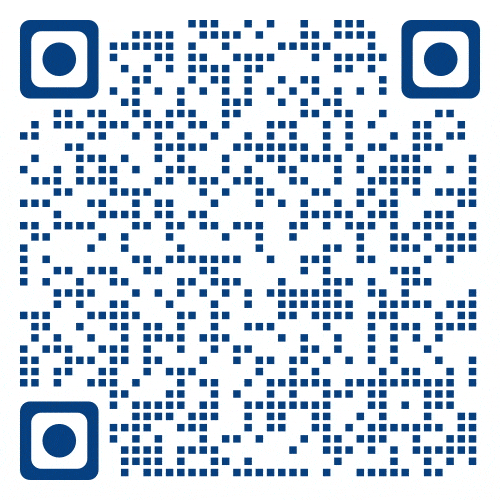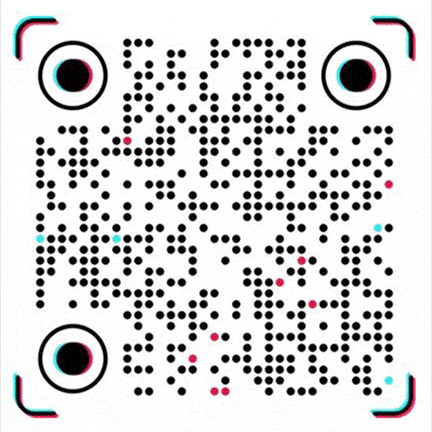Pourquoi la croissance économique à long terme déçoit souvent ?
Du point de vue des années 1950, le progrès économique des États-Unis au cours des 70 années suivantes a été une énorme déception. Les futuristes prévoyaient un monde de super-pills, de fermes spatiales et de villes enfermées dans du verre. La science et la technologie généreraient des richesses sans fin et tout ce que les consommateurs pourraient jamais désirer. Pourtant, la vitesse des gains réalisés pendant l'ère spatiale, il s'est avéré, a rapidement diminué : entre 2000 et 2019, le revenu réel par habitant des États-Unis a augmenté de 1,2 % par an en moyenne, contre 2 % entre 1980 et 1999 et 2,5 % dans les années 1950. Et au lieu de voitures volantes, Peter Thiel, un capital-risqueur, avait un jour raillé, nous avons eu 140 caractères.
Un nouvel article suggère qu'une telle déception n'est pas justifiée - car elle découle d'une énorme mécompréhension de la façon dont le progrès économique se produit. Thomas Philippon, professeur de finance à l'Université de New York, soutient que l'expérience d'après-guerre était inhabituelle. En examinant les données américaines remontant à 1890 et les données britanniques de 1600 à 1914, il constate que, lorsque le progrès technologique est correctement compris, le monde a été sur un chemin globalement similaire pendant des siècles. En d'autres termes, dans le grand schéma des choses, il n'y a eu aucun ralentissement du tout.
Le point de départ de la plupart des économistes pour réfléchir à la croissance est l'article de Robert Solow de 1956, "Une contribution à la théorie de la croissance". Le modèle de M. Solow pour prédire la richesse à long terme d'un pays repose sur ce qu'il appelle la "fonction de production". C'est une boîte noire mathématique : d'un côté, le travail et le capital entrent ; de l'autre sortent tous les biens et services de consommation qui contribuent au niveau de vie des personnes. Une façon de croître est évidente : introduire plus de travail et de capital dans la boîte. Mais cela ne peut pas offrir des améliorations indéfiniment. Ajouter plus de travail signifie que la production est répartie entre plus de travailleurs. Et le capital s'use, donc plus d'investissements sont nécessaires au fil du temps juste pour rester à la même place.
Au lieu de cela, la croissance à long terme ne peut venir que de l'amélioration de la boîte noire - la manière dont le travail et le capital sont combinés. Le terme élégant que les économistes donnent à cela est la productivité totale des facteurs (ptf), bien qu'ils s'y réfèrent parfois avec des étiquettes plus intuitives, telles que technologie ou connaissance. Vous pouvez le considérer comme une recette. D'un côté se trouvent le travail et le capital, les ingrédients. De l'autre, le plat fini : la production économique. La ptf est une tentative de mesurer à quel point la recette est efficace pour combiner les ingrédients, ce qui dépend à son tour de facteurs tels que le niveau d'éducation proposé à la population, la qualité de la gestion des entreprises et la profondeur du savoir scientifique.
M. Solow supposait que la contribution annuelle de la ptf au pib croîtrait de manière exponentielle. Cela pouvait être pour des raisons purement mathématiques : il voulait que son modèle économique croisse à un taux fixe, disons 2 % par an, ce qui nécessitait des gains toujours plus importants à mesure que le pib devenait plus grand pour maintenir un rythme de croissance constant. Plus tard, des économistes, dont Paul Romer (comme M. Solow, un lauréat du prix Nobel), ont essayé de comprendre la chimie sous-jacente à la croissance exponentielle présumée de la ptf. Leurs théories soutiennent généralement qu'un certain investissement ne va pas dans le capital, mais dans la recherche et le développement. Et parce que la connaissance peut être copiée librement, ils observent que cet investissement a un produit marginal croissant, ce qui signifie que chaque recherche antérieure rend la recherche suivante plus efficace. La connaissance se propage ainsi, créant plus de connaissance au fur et à mesure, semblable à la façon dont un virus se propage au début d'une épidémie.
Le problème, selon M. Philippon, est que le tfp ne croît en réalité pas de manière exponentielle. En utilisant les sources de données les plus populaires pour la croissance à long terme, il compare les prévisions de deux modèles différents avec les tendances observées dans le tfp. Un schéma linéaire—qu'il appelle « croissance additive »—s'adapte systématiquement mieux à la façon dont le progrès s'est réellement déroulé. Contrairement aux théories existantes, cela suggère que les recherches précédentes ne rendent pas la prochaine idée plus facile à trouver. Cela explique également pourquoi, comme le dit M. Philippon, certains économistes continuent de prédire une future vague d'innovation qui n'arrive jamais.
Ce n'est pas un conseil de désespoir. Bien que le taux de croissance en pourcentage puisse ralentir, le modèle de M. Philippon prédit que la taille de tout accroissement est à peu près constante. Les sociétés deviennent plus riches—mais pas aussi vite que l'on pense généralement.
Encourageant, M. Philippon trouve également des preuves de moments où le taux de croissance du tfp s'accélère temporairement et où l'increment annuel devient plus élevé. Son article trace un de ces moments en Grande-Bretagne entre 1650 et 1700, et un autre vers 1830, en accord avec les dates où les historiens situent les première et seconde Révolutions industrielles. Il en trouve également un en Amérique vers 1930, qu'il attribue à l'adoption de l'électrification. De tels moments semblent ne se produire qu'environ tous les siècles. Mais ils aident à expliquer l'erreur de M. Solow : il aurait été facile pour lui, alors qu'il vivait l'une de ces périodes d'accélération, de tomber dans l'illusion du progrès exponentiel.
Les voies de la croissance sont insondables.
L'analyse statistique de M. Philippon ne s'attaque pas aux problèmes conceptuels plus profonds du tfp. L'un d'eux est que le capital est difficile à évaluer. Il y a généralement une différence entre son coût historique, correctement amorti, et la valeur actualisée des bénéfices qu'il produira finalement. Contrairement au travail, qui peut être quantifié en heures, il n'existe pas d'unité non monétaire avec laquelle évaluer les plateformes pétrolières et les brevets pharmaceutiques. Après la publication de l'article de M. Solow en 1956, un groupe d'économistes de l'Université de Cambridge a montré que sa méthode d'évaluation du capital était circulaire, un point que les partisans de M. Solow ont concédé. Mais le modèle est toujours largement utilisé malgré cela
Des problèmes similaires affectent le tfp lui-même. Les techniques statistiques qui tentent de mesurer le concept de 'connaissance' regroupent généralement toute la variation de la croissance qui ne peut être expliquée par des changements dans la main-d'œuvre ou les investissements dans la boîte noire. D'où le deuxième nom, moins flatteur, du tfp - le 'résidu de Solow'. Plutôt qu'un indicateur fiable du niveau de connaissance de la société, le tfp semble jusqu'à présent, dans les mots d'un critique de Solow, être une 'mesure de notre ignorance'.